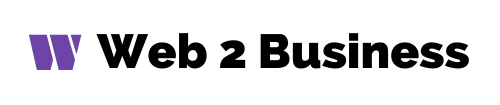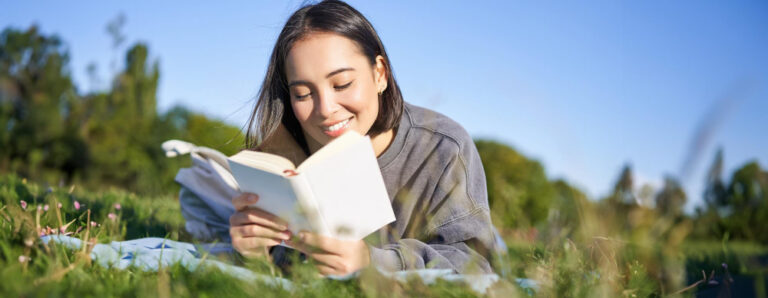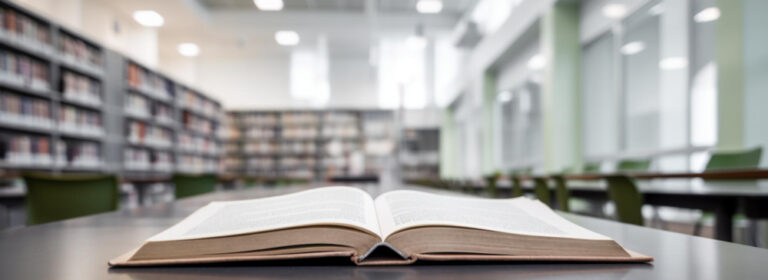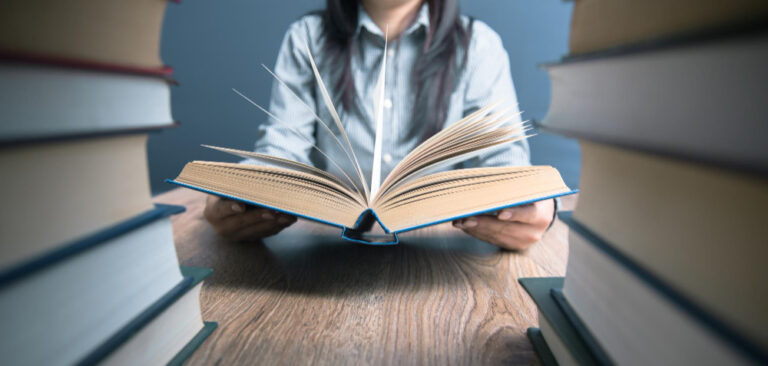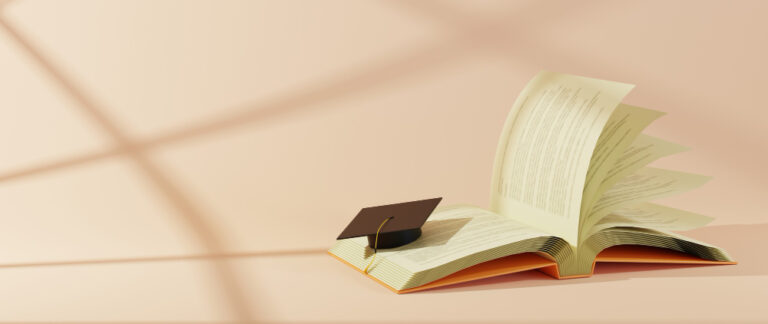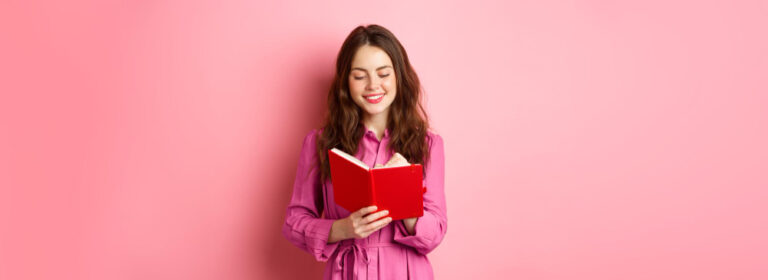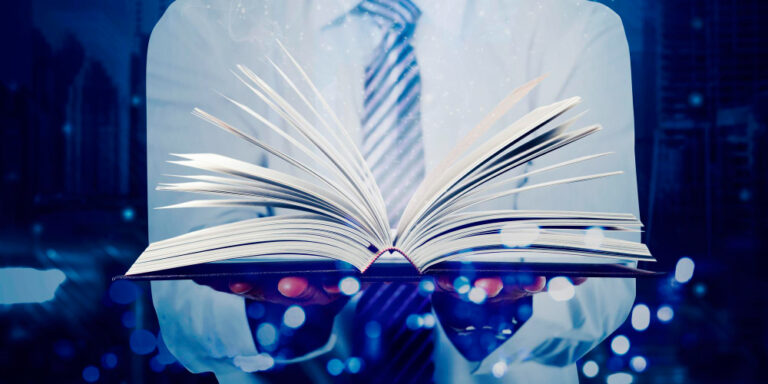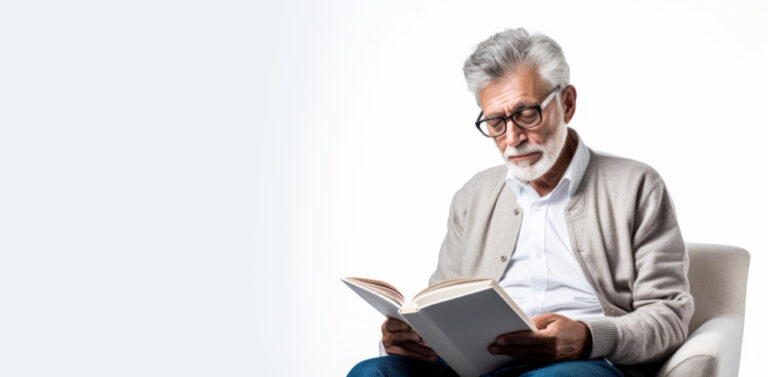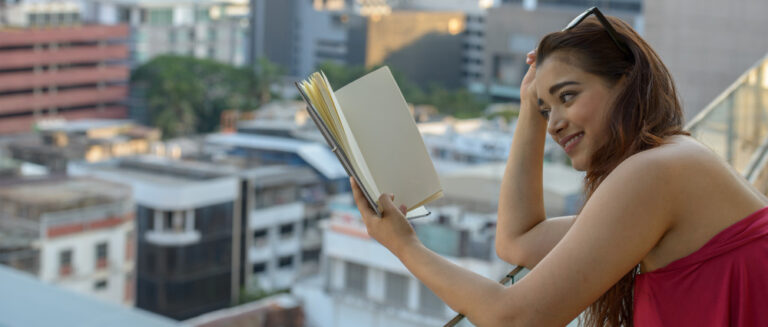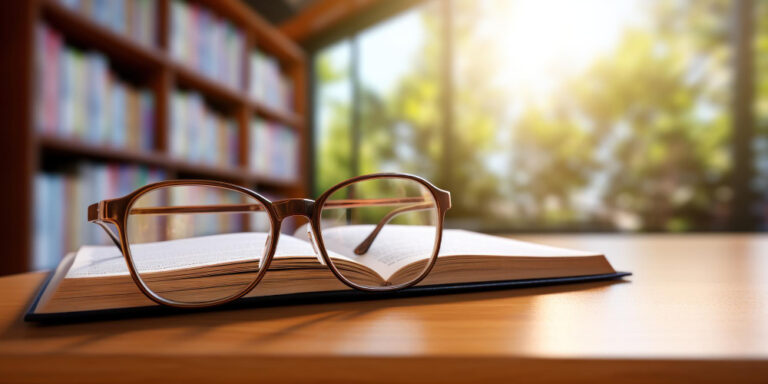J’ai beau adorer la psychologie positive, parfois ça ne marche juste pas, même pour moi. Il existe un autre moyen qui peut paraître bizarre, mais qui marche encore : travailler. Vous savez, il vous arrive bien parfois de passer une semaine où vous ne faites que travailler ? Même si généralement vous aimez votre métier, il ne se passe rien d’excitant pendant quelques jours, vous avez beaucoup de deadlines et vous travaillez pour que tout soit fait.
C’est le mode que j’ai adopté et que j’utilise actuellement et bizarrement, c’est toujours plutôt satisfaisant. Probablement parce que c’est libérateur de ne pas tout le temps déborder d’ondes positives. Mark Manson ce blogueur demi-dieux, a trouvé une meilleure expression pour ce mode de fonctionnement. L’art subtil de s’en f*utre, son premier « bon » livre, ce best-seller instantané du New York Times, est un guide d’auto-assistance sérieux pour les gens qui détestent habituellement l’auto-assistance.
Mark Manson comprend que la vie est devenue accablante et que la seule façon de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour nous est de ne pas se f*utre du reste.
Voici mes 3 règles favorites :
- Les valeurs que vous ne pouvez pas contrôler ne sont pas de bonnes valeurs à suivre
- Ne croyez pas que vous savez tout sur tout, car cela vous permet de vous améliorer
- Essayez de laisser de côté un héritage qui peut détruire votre vie
L’astuce pour arriver à se f*utre de la plupart des choses est de ne pas le faire pour ce qui compte vraiment pour vous. Voyons comment nous pouvons nous rapprocher de cet idéal !
Règle n°1 : Ne portez pas des valeurs que vous ne contrôlez pas
Mark Manson est un gars très stoïcien, cela transparaît dans ses écrits et ses conseils. Une idée de base du Stoïcisme est de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. C’est plutôt facile à comprendre et à mettre en pratique quand il s’agit de vos actions, mais cela peut être appliqué à des aspect de votre vie plus moins tangibles également.
Prenez vos valeurs par exemple. Je sais qu’il est dur de les mettre en mots, mais si vous essayez de les décrire, faites-le en trois adjectifs, et vous aurez déjà une bonne idée des valeurs qui vous guident dans la vie. Admettons par exemple que vous ayez choisi les mots « honnête », « ponctuel » et » populaire ». Voici la remarque que fait Mark Manson : Choisissez seulement les valeurs que vous pouvez contrôler.
La plupart d’entre nous abandonnent leurs idéaux lorsqu’ils grandissent, essayent de faire carrière et de gagner de l’argent. Bien que cela fasse partie de la vie réelle, il est important de ne pas lâcher complètement le volant. Les valeurs que vous ne contrôlez pas sont mauvaises, car elles seront une source constante de souffrance inutile dans votre vie.
Si l’on considère les trois règles que nous venons de mentionner, l’honnêteté est une valeur que vous contrôlez à 100%. Vous seul savez à quel point vous êtes honnête, et personne d’autre n’a besoin de le savoir. La ponctualité est en partie sous votre contrôle. Si vous partez toujours avec une avance suffisante, vous pouvez compenser la plupart des obstacles potentiels. La popularité, en revanche, est totalement hors de votre portée. Bien sûr, vous pouvez être gentil et amical avec tout le monde, mais vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres. Certains vous détesteront toujours, quoi que vous fassiez.
Par conséquent, la popularité n’est pas la meilleure valeur sur laquelle se concentrer et vous pourriez essayer de la remplacer par une autre, plus contrôlable comme la gentillesse.
Règle n°2 : La certitude, un frein à la croissance
Quel incroyable principe que celui-ci, énoncé en si peu de mots : la croissance, un frein à la croissance. Imaginez que vous puissiez choisir entre deux modes de vie : un dans lequel vous pourriez penser que tout ce que vous pensez est vrai à 100%, et un autre dans lequel vous penseriez que tout ce que vous connaissez est 100 % faux. Ces deux modes sont stressants, mais lequel des deux vous aiderait à prendre de meilleures décisions, selon vous ?
Le deuxième, évidemment. Alors que l’on doit trouver un juste milieu entre les deux, rejeter l’idée que vous connaissez quelque chose de vrai est une excellente base pour commencer à apprendre. Ceci est vrai pour ce qui concerne la découverte de vérités factuelles, par exemple, utiliser la méthode scientifique pour élaborer une hypothèse d’entreprise permet d’arriver à de meilleures conclusions, mais c’est également vrai pour l’acquisition de vérités conceptuelles.
Le second mode est une connaissance plus implicite des relations entre différentes entités. Prenons par exemple votre place dans la hiérarchie sociale à l’école. Si vous êtes convaincu d’être laid, vous serez très triste. Mais si vous remarquez que vous recevez beaucoup de compliments à l’école, que les gens vous trouvent charmant et que certains ont le béguin pour vous, c’est la preuve que votre cerveau se joue de vous avec de fausses certitudes.
Si vous vous permettez d’avoir un petit doute, vous pouvez alors réfuter cette croyance limitante que vous avez sur toi-même.
Règle n°3 : Ne soyez pas obsédé par l’idée de laisser un héritage
Voici un rappel désagréable, mais important : Vous allez mourir un jour. Nous allons tous mourir un jour. Que nous l’admettions ou non, quand le moment approche, nous avons tous peur. C’est pourquoi beaucoup d’entre nous veulent laisser un héritage, moi y compris. Cependant, Mark Manson dit que cela pourrait ruiner le peu de temps précieux que nous avons ici sur terre.
Plus on nous pousse à faire de grandes choses, plus on commence à courir après la gloire, à travailler trop et à se concentrer sur l’avenir. Et si, au lieu de cela, nous essayions simplement d’être utiles dans le présent ? Nous pourrions encore aider une tonne de gens, profiter de nos journées et être pleinement présents, tant que nous sommes ici.
La position de Mark Manson est claire : trouvez des moyens de vous donner, ainsi qu’à vos proches et aux personnes que vous rencontrez, de la joie dans le présent et laissez la partie héritage s’occuper d’elle-même.